Lucia di Lammermoor
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
Lucia di Lammermoor – Gaetano Donizetti
Opéra | Contemporain
Durée : 3 heures 15 minutes, avec un entracte
Langue : Italien
Surtitres : Hongrois, Anglais, Italien
Lucia di Lammermoor est l'exemple parfait du style italien de son époque : elle incarne à la perfection la période précédant Bellini et Verdi, ainsi que l’opéra italien bel canto, mélodique et sentimental. Parmi les 67 opéras composés par Donizetti, celui-ci occupe sans doute une place centrale : bien que ses œuvres comiques soient les plus souvent jouées, c’est dans ce drame que le grand humoriste a concentré tout son art tragique. Sa musique, tout comme le livret de Cammarano, reflète admirablement la passion et l’atmosphère surnaturelle du roman The Bride of Lammermoor de Walter Scott, dont l’œuvre est inspirée. Un conflit ancestral entre deux familles alimente cette histoire d’amour, qui figure depuis sa création au répertoire régulier des maisons d’opéra.
Le drame de Lucia, contrainte à des choix qui la mèneront à perdre la raison, est présenté à l’Opéra dans une mise en scène de Máté Szabó.
Restriction d’âge : Le spectacle est déconseillé aux enfants de moins de 14 ans.
Argument
L'action se déroule dans l'Écosse de la fin du XVIIe siècle. Les familles luttent entre elles, tandis que les guerres entre catholiques et protestants font rage. Les Ashton — depuis longtemps les grands rivaux des Ravenswood — ont pris possession du château de ces derniers, situé près de Lammermoor.
Acte I
Bref et sombre prélude. Enrico Ashton se désespère sur le sort de sa famille au bord de la banqueroute auprès du chapelain Raimondo. Il déclare que seul le mariage arrangé de sa sœur Lucia avec Lord Arturo pourrait les sauver, mais que Lucia s'oppose à cette idée. Normanno, le veneur d'Enrico, annonce que son refus est dû au fait qu'elle aime Edgardo de Ravenswood, l'ennemi juré d'Enrico. Ce dernier jure de mettre fin aux relations entre sa sœur et son amant.
Près d'un puits dans le parc du château
Lucia attend l'arrivée d'Edgardo en compagnie de sa dame de compagnie Alisa. Lucia confie à cette dernière qu'elle a récemment vu en rêve le spectre d'une jeune femme assassinée par son amant — un Ravenswood — dont le corps serait encore dans le puits. Alisa lui conseille alors d'oublier Edgardo, mais Lucia se moque de cet avertissement. Arrive Edgardo qui annonce à Lucia qu'avant son départ pour la France, il compte demander sa main à son frère. Mais celle-ci l'en dissuade, redoutant une réaction violente de la part d'Enrico. Edgardo, furieux, lui remémore son serment de vengeance contre la famille de Lucia responsable de la mort de son père. Lucia parvient à le calmer, et Edgardo part après avoir échangé avec sa fiancée des preuves d'amour sous la forme d'un anneau.
Acte II
Les appartements d'Enrico
Des mois ont passé sans qu'Edgardo ne donne de ses nouvelles. C'est en fait Enrico qui a donné l'ordre d'intercepter toutes ses lettres. Il a également arrangé un mariage entre sa sœur et Arturo Bucklaw. Les invités et Arturo arrivent au château lorsque Lucia entre, pâle. Elle reproche à son frère son manque d'humanité et lui rappelle qu'Edgardo lui a demandé sa main. Enrico lui montre alors une fausse lettre censée prouver l'infidélité de l'absent. Finalement, Raimondo arrive à convaincre Lucia d'épouser Arturo en invoquant la mémoire de sa mère. Face au chantage du chapelain, elle accepte, mais est bien décidée à se donner la mort une fois le mariage consacré.
Une salle décorée pour accueillir Arturo
Arturo est accueilli par un chœur. Enrico le prépare à la réaction de sa sœur. Cette dernière arrive et, indifférente, signe le contrat de mariage. Edgardo survient, réclamant sa fiancée. S'ensuit un sextuor avec chœur décrivant la tournure particulière des événements. Enrico, Arturo et Edgardo s'apprêtent à se battre lorsque Raimondo montre le contrat de mariage signé de la main de Lucia. Edgardo reprend l'anneau de sa fiancée et s'enfuit en la maudissant. Ce sextuor est l'un des passages dramatiques les plus remarquables de toute l'histoire de l'opéra.[réf. nécessaire]
Acte III
Une salle de la tour de Wolferag
Enrico rendu fou de rage par l'intrusion d'Edgardo, qui est son rival politique, se rend chez celui-ci et le provoque en duel, espérant ainsi en finir avec le jeune homme qui est l'ultime représentant de la famille Ravenswood ennemie des Ashton depuis des siècles.
Salle de réception du IIe acte
Alors que se déroulent les festivités du mariage, Raimondo bouleversé surgit soudain et annonce aux invités horrifiés que Lucia a tué Arturo et qu'elle est devenue folle. La jeune fille arrive hagarde, échevelée et ensanglantée. Dans la célèbre « scène de folie » (Il dolce suono), elle rêve son avenir, unie avec Edgardo, tandis que le puits du premier acte devient l'autel de leur mariage. Enrico qui revient de chez Edgardo se fait confirmer la nouvelle du meurtre d'Arturo et, sans se rendre compte de l'état de sa sœur, la menace d'une peine exemplaire ; Raimondo et les invités interviennent à temps et lui font comprendre que la malheureuse n'est déjà plus dans le monde des vivants. Lucia prenant son frère pour son bien-aimé Edgardo implore son pardon avant de le prier de veiller sur sa tombe. Après qu'elle s'est effondrée, on l'emporte, mourante.
Cette scène de la folie est l'occasion pour l'interprète de Lucia de déployer sa virtuosité et sa technique dans une très belle scène dont le point central, la cadence, semble avoir été ajouté postérieurement à la création ; cet ajout a pu être apporté à partir de 1889, par Mathilde Marchesi, professeur de la cantatrice Nellie Melba.
Les tombes des Ravenswood
Edgardo attend Enrico avec l'intention de se jeter sur l'épée de son ennemi, ignorant le sort tragique de son ancienne fiancée. Il apprend par les familiers des Ashton qu'elle va bientôt mourir, et que dans sa démence elle réclame Edgardo. En entendant sonner le glas, il comprend que Lucia est morte, ce qui lui est confirmé par le chapelain Raimondo Bideben. Désespéré, il se suicide en se poignardant ; il meurt en prononçant le nom de sa bien-aimée.
Programme et distribution
Direction musicale : János Kovács
Enrico – Michele Kalmandy, Alexandru Agache
Lucia – Erika Miklósa, Zita Szemere
Edgardo – István Horváth, Adorján Pataki
Arturo – Tibor Szappanos
Raimondo – István Kovács
Alisa – Lusine Sahakyan
Normanno – Balázs Papp
Avec l’Orchestre, le Chœur et le Chœur d’enfants de l’Opéra d’État hongrois
Mise en scène : Máté Szabó
Décors : Balázs Cziegler
Costumes : Ildi Tihanyi
Chorégraphie : Csaba Sebestyén
Dramaturgie et traduction hongroise : Eszter Orbán
Traduction anglaise : Arthur Roger Crane
Direction du chœur : Gábor Csiki
Opéra d'État hongrois
INFORMATION EN CAS DE MAISON COMPLETE !
Si toutes les places sont épuisées pour l'heure sélectionnée, mais que vous voulez quand même voir notre production ce jour-là, nous commencerons à vendre 84 de nos places debout extrêmement abordables 2 heures avant le début de la représentation, avec lesquelles vous pourrez visiter le galerie au 3ème étage. Les billets peuvent être achetés à la billetterie de l'Opéra et sur notre interface en ligne. Nous attirons votre attention sur le fait que la scène n'est visible que de manière limitée depuis les places debout et les sièges latéraux, mais en même temps, le suivi de la représentation est également soutenu par une diffusion télévisée sur place.
L'Opéra d'État hongrois (hongrois : Magyar Állami Operaház , prononcé [ˈmɒɟɒɾ ˈaːllɒmi ˈopɛɾɒhaːz]) est une salle d'opéra de style néorenaissance, située à Budapest. Il héberge l'opéra national de Hongrie.
Avant 1873, la ville de Budapest n'existait pas, seules existaient Buda, Pest et Óbuda. À cette date, ces trois villes furent réunies et Budapest est née. Le tourisme a connu une expansion considérable entraînant la construction de cafés et de restaurants. La nécessité d'une salle d'opéra s'est rapidement faite sentir pour promouvoir la culture.
L'empereur François-Joseph d'Autriche-Hongrie confie à Miklós Ybl, un des architectes hongrois le plus coté du xixe siècle, le soin de réaliser l'ouvrage. La construction dure 9 ans, de 1875 au 27 septembre 1884, date de l'inauguration.
Le bâtiment, richement décoré, est considéré comme un chef-d'œuvre d'architecture néorenaissance avec, cependant, des éléments de style baroque. L'ornementation est réalisée par des artistes hongrois renommés à l'époque : Bertalan Székely,Mór Than et Károly Lotz. Bien que le bâtiment ne soit pas considéré comme le plus important, son esthétique et sonacoustique le classent parmi les premières salles d'opéra dans le monde.
Le bâtiment
L'auditorium de 1261 places, en forme de fer à cheval (d'après les calculs réalisés en 1970 par un groupe d'architectes internationaux), a la troisième meilleure acoustique en Europe après la Scala et l'Opéra Garnier. Bien que beaucoup de salles aient été construites depuis, l'Opéra national de Hongrie reste parmi les meilleurs en termes d'acoustique.
Sur la façade du bâtiment trônent les statues de Ferenc Erkel, compositeur de l'Himnusz, hymne national hongrois, du premier directeur de l'opéra et à l'origine de laSociété philharmonique de Budapest, ainsi que celle de Franz Liszt, le compositeur hongrois bien connu.
Chaque saison s'étend du mois de septembre à la fin du mois de juin. Outre la présentation d'opéras, le bâtiment abrite le Ballet national hongrois.
Beaucoup d'artistes de renom ont été invités à se produire. Parmi ceux-ci, le compositeur Gustav Mahler qui a également été chef d'orchestre à Budapest de 1888 à1891 et Otto Klemperer qui a été le directeur musical pendant trois ans de 1947 à 1950.
Des travaux de rénovation importants sont entrepris en 1980 sur des fonds de l'état hongrois. Ils durent jusqu'en 1984. La réouverture de la salle a lieu le27 septembre 1984, soit exactement 100 ans après son ouverture initiale.
Le second opéra national est le théâtre Erkel (hu). Il est bien plus grand et abrite également un ballet.
Des visites guidées en six langues (En français notamment) ont lieu tous les jours à 15 et 16 heures.
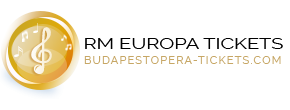
 FR
FR EN
EN DE
DE IT
IT ES
ES RU
RU JP
JP RO
RO
 Plan de la salle
Plan de la salle 